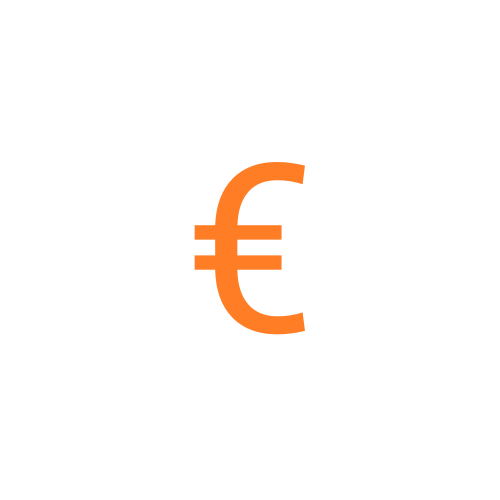Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » La stimulation cérébrale profonde dans le traitement de Parkinson
Les « bons jours » alternent avec des périodes « off » difficiles, où les gestes se bloquent et la fatigue pèse. Quand les médicaments n’apportent plus un contrôle suffisant, la stimulation cérébrale profonde de Parkinson peut devenir une piste à explorer. On vous explique, simplement, en quoi consiste la technique, à qui elle s’adresse, ce qu’elle peut apporter et comment se passe le parcours, pour vous aider à en parler sereinement avec votre équipe soignante.
Qu’est-ce que la stimulation cérébrale profonde ?
Principe et cibles cérébrales
La stimulation cérébrale profonde est une technique thérapeutique qui repose sur l’implantation, au cours d’une neurochirurgie fonctionnelle, de fines électrodes dans certaines zones du cerveau ainsi que d’un boîtier stimulateur, placé sous la peau, généralement sous la clavicule.
Une fois en place, ce dispositif délivre des impulsions électriques réglables qui modulent l’activité des circuits du mouvement, sans détruire de tissu.
Les deux cibles les plus utilisées sont le noyau sous-thalamique (STN) et le globus pallidus interne (GPi). Le choix de la cible dépend du profil de chaque patient, de ses symptômes et des objectifs de traitement.
Comment agit la stimulation cérébrale profonde ?
Dans la maladie de Parkinson, le cerveau reçoit moins de dopamine, un « messager » qui aide à lancer et coordonner les gestes. Le signal moteur devient alors brouillé.
La stimulation cérébrale profonde envoie de toutes petites impulsions électriques, régulières, aux zones concernées. Cela remet du rythme : les tremblements diminuent, les périodes « off/on » sont plus stables et les mouvements involontaires (dyskinésies) s’atténuent.
Selon la cible choisie, elle peut permettre d’ajuster à la baisse certaines doses médicamenteuses tout en préservant l’efficacité motrice. Les paramètres (intensité, fréquence, contact d’électrode) sont entièrement programmables, ce qui autorise des réglages sur mesure sans interrompre l’évolution naturelle de la maladie.
⏩ Écoutez notre replay pour mieux comprendre les mécanismes de la maladie de Parkinson et les pistes actuelles de traitement.
Stimulation cérébrale profonde pour Parkinson : indications et critères d’éligibilité
Quand envisager la stimulation cérébrale profonde avec une maladie de Parkinson ?
On la propose lorsque la maladie provoque des fluctuations motrices gênantes malgré un traitement bien conduit, en présence de dyskinésies invalidantes ou d’un tremblement résistant aux médicaments.
La décision se prend au terme d’une évaluation pluridisciplinaire. Neurologue, neurochirurgien, neuropsychologue et équipe d’imagerie examinent le dossier, confirment le diagnostic, mesurent la réponse à la dopamine et estiment la balance bénéfice/risque selon la situation personnelle.
Profil des candidats
On envisage cette opération selon certains critères :
→ bonne sensibilité à la L-dopa ;
→ absence de démence sévère ou de troubles psychiatriques non stabilisés ;
→ état général compatible avec une chirurgie.
Une IRM cérébrale préopératoire vérifie l’absence de contre-indication.
La limite d’âge n’est pas stricte. On raisonne surtout selon le projet de vie de la personne. La recommandation est individualisée et discutée longuement avec le patient et ses proches, en tenant compte des attentes et des priorités.
Bénéfices attendus et limites de la stimulation cérébrale profonde chez les patients parkinsoniens
Amélioration des symptômes moteurs
La DBS (Deep Brain Stimulation) peut diminuer l’akinésie (lenteur d’initiation des mouvements), assouplir la rigidité et atténuer les tremblements.
En pratique, la stimulation du noyau sous-thalamique (STN) s’accompagne souvent d’une réduction des doses de médicaments, quand la stimulation du globus pallidus interne (GPi) est parfois privilégiée si les dyskinésies dominent le tableau.
Les choix se font au cas par cas selon le profil moteur, cognitif et les objectifs (réduction de dose, tolérance, équilibre global).
Effets non moteurs : quoi attendre (et ne pas attendre)
Beaucoup de patients rapportent une qualité de vie améliorée grâce à des journées plus stables et moins de douleur liée aux fluctuations.
En revanche, la stimulation ne ralentit pas la progression de la maladie. Elle agit sur les symptômes, pas sur la cause.
Les troubles de la marche, de l’élocution ou certaines difficultés cognitives répondent de manière inconstante. D’où l’importance d’objectifs réalistes fixés avec l’équipe, afin d’éviter les déceptions.
Limites
Trouver le réglage optimal demande parfois plusieurs consultations, les premiers mois.
Les résultats varient d’une personne à l’autre, et des effets indésirables transitoires (troubles de la parole, de l’équilibre, de l’humeur) peuvent survenir lors des ajustements.
La réussite repose donc sur un suivi rapproché, une communication ouverte et des réglages fins.
Maladie de Parkinson : Risques et effets indésirables d’une stimulation cérébrale
Comme toute intervention intracrânienne, la stimulation cérébrale profonde expose à des complications peu fréquentes, mais à connaître :
→ infection du matériel ;
→ hémorragie au moment de l’implantation ;
→ crises d’épilepsie ;
→ mauvaise position d’électrode ;
→ usure de composants nécessitant une révision.
Des effets liés à la stimulation elle-même peuvent aussi apparaître (troubles de la parole, de l’humeur, de l’équilibre) et sont en général réversibles par reprogrammation.
Le niveau de risque dépend du terrain médical et du respect des consignes pré- et post-opératoires.
⏩ Découvrez comment les dons accélèrent les essais, équipent les centres et améliorent l’accompagnement des patients parkinsoniens.
Stimulation cérébrale profonde : comment se déroule l’intervention ?
1. Bilan préopératoire
Le parcours commence par un bilan complet :
→ IRM de repérage ;
→ tests moteurs standardisés ;
→ évaluation neuropsychologique ;
→ entretiens avec le neurologue et le neurochirurgien.
On précise les objectifs, on choisit la cible (STN ou GPi) et on explique les bénéfices, les risques et les contraintes pratiques. Ce temps d’échanges permet d’aligner les attentes et d’anticiper la programmation.
2. Pose des électrodes et du boîtier
L’implantation se fait sous guidage stéréotaxique (méthode d’imagerie médicale en 3D permettant de repérer avec précision une petite lésion). Une électrode est placée de chaque côté lorsque nécessaire.
Selon les centres, certaines étapes se déroulent patient éveillé pour affiner le ciblage grâce à des enregistrements et à l’observation immédiate des effets.
Le boîtier est ensuite implanté sous la peau, le plus souvent sous la clavicule, et relié aux électrodes par une extension sous-cutanée. L’hospitalisation est généralement courte, mais avec une surveillance rapprochée au début.
3. Première programmation
La mise en route a lieu quelques semaines après la chirurgie, le temps de la cicatrisation.
Les réglages (intensité, fréquence, contact actif) sont ajustés progressivement pour maximiser le bénéfice et limiter les effets indésirables. Les traitements médicamenteux sont souvent adaptés en parallèle.
Selon le modèle, la batterie est rechargeable ou doit être remplacée après plusieurs années. Ce remplacement est une procédure simple comparée à la pose initiale.
Vie après l’implantation pour les patients parkinsoniens : suivi et précautions
Points pratiques
En déplacement, gardez toujours la carte de votre dispositif. Dans les aéroports, signalez-le et privilégiez un contrôle manuel plutôt que les portiques.
L’activité physique est encouragée, avec du bon sens. Il est indispensable de protéger la zone du boîtier et éviter les traumatismes directs.
La compatibilité avec un IRM dépend du modèle implanté et des réglages du jour. Ne programmez aucun examen sans l’avis de l’équipe qui vous suit et du service d’imagerie.
Quel suivi prévoir ?
La première année, les rendez-vous sont rapprochés pour affiner les réglages et adapter les médicaments.
Une fois l’équilibre trouvé, le rythme s’espace, mais reste régulier, afin de vérifier le matériel, anticiper la fin de batterie et ajuster la prise en charge rééducative (kinésithérapie, orthophonie, activité physique adaptée).
Est-ce réversible ?
La stimulation est entièrement ajustable et peut être interrompue si besoin. Le matériel peut également être retiré en cas d’intolérance, d’infection ou de décision partagée de changer de stratégie.
Cette réversibilité contribue à la sécurité globale de la démarche, tout en rappelant que la DBS n’est jamais une obligation, mais une option parmi d’autres.
Bien choisie et bien réglée, la stimulation cérébrale profonde peut lisser les fluctuations, réduire les dyskinésies et redonner de la stabilité au quotidien, sans prétendre guérir la maladie. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, discutez-en avec votre neurologue ou un centre expert. Une évaluation personnalisée permettra de peser les bénéfices et les contraintes et d’avancer, ensemble, vers la solution la plus adaptée.
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
• ACTIVA RC – HAS
• ACTIVA SC – HAS
• Zhang, J., Li, J., Chen, F., Liu, X., Jiang, C., Hu, X., … & Xu, Z. (2021). STN versus GPi deep brain stimulation for dyskinesia improvement in advanced Parkinson’s disease: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical neurology and neurosurgery, 201, 106450.
• Zarate-Calderon, C., Castillo-Rangel, C., Viveros-Martínez, I., Castro-Castro, E., García, L. I., & Marín, G. (2025). Risk of Cerebrovascular Events in Deep Brain Stimulation for Parkinson’s Disease Focused on STN and GPi: Systematic Review and Meta-Analysis. Brain Sciences, 15(4), 413.
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.