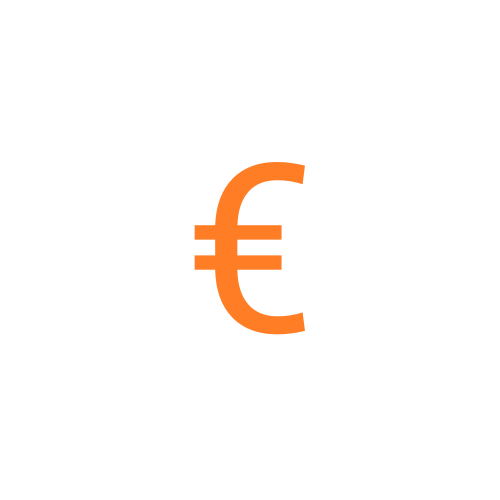Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » AVC ischémique : rôle de l’IRM dans le diagnostic et la prise en charge
L’AVC ischémique est une urgence médicale causée par l’occlusion d’une artère, privant une région du cerveau d’oxygène et de glucose et entraînant des dommages neuronaux potentiellement irréversibles. La rapidité du diagnostic et de la prise en charge est vitale pour préserver le tissu cérébral encore viable et améliorer le pronostic fonctionnel du patient. Dans le cas de l’AVC ischémique, l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) s’est imposée comme la modalité d’imagerie de référence, surpassant souvent la TDM (tomodensitométrie) dans l’évaluation initiale. Explorons comment elle permet d’évaluer les lésions cérébrales, pour déterminer la meilleure prise en charge et améliorer le pronostic des patients.
Qu’est-ce qu’un AVC ischémique ?
Définition et mécanisme physiopathologique
L’AVC ischémique, aussi appelé infarctus cérébral, est causé par l’occlusion soudaine d’une artère cérébrale par un caillot sanguin. Le tissu cérébral privé de sang cesse de recevoir l’oxygène nécessaire et les neurones meurent en quelques minutes.
On décrit ainsi une zone centrale de nécrose définitive, et une zone périphérique dite « pénombre ischémique » où les neurones sont affaiblis, mais encore récupérables si la circulation est rétablie à temps.
La gravité dépendra du volume de tissu atteint et de la présence de voies de suppléance artérielles.
Différence entre AVC ischémique et hémorragique
Contrairement à l’AVC ischémique, l’AVC hémorragique (qui représente 20 % des cas) résulte de la rupture d’un vaisseau sanguin avec hémorragie dans le cerveau. Cliniquement, les symptômes peuvent être similaires, mais les causes sont différentes. L’un est dû à un caillot, l’autre à un saignement.
L’imagerie médicale permet de trancher entre ces 2 formes d’AVC. Le scanner cérébral permet de différencier rapidement l’hémorragie et l’infarctus. L’IRM confirme quant à lui l’ischémie et affine le diagnostic.
AVC ischémique : les symptômes qui doivent alerter
Les symptômes d’un AVC apparaissent de façon brutale. Parmi les signes fréquents, on retrouve :
→ une faiblesse ou une paralysie d’un bras, d’une jambe ou d’un côté du visage, le plus souvent d’un seul côté du corps (hémiplégie) ;
→ des engourdissements et troubles de la sensibilité ;
→ une perte de vision d’un œil ou d’une moitié du champ visuel ;
→ des troubles de la parole (dysarthrie, aphasie) ou de la compréhension ;
→ des troubles de l’équilibre ;
→ un mal de tête très soudain et intense.
Devant l’un de ces symptômes, appelez immédiatement les services d’urgence, afin de réaliser une imagerie cérébrale le plus rapidement possible.
LIRE AUSSI : Symptômes d’un AVC : reconnaître les signes d’urgence
AVC ischémique : l’IRM comme examen diagnostique de référence
Sensibilité très élevée de l’IRM aux lésions précoces de l’AVC
L’IRM, et en particulier la séquence de diffusion (DWI), repère l’infarctus cérébral très tôt, ce qui est particulièrement précieux pour permettre une reperfusion rapide. En effet, les mouvements de l’eau dans les cellules changent dès les premières minutes d’ischémie.
En revanche, le scanner (TDM) est souvent normal dans les premières heures, car les signes d’ischémie y sont encore peu visibles.
LIRE AUSSI : AVC : l’IRM cérébrale pour confirmer le diagnostic
AVC ischémique et IRM : caractérisation précise des tissus
L’IRM offre une résolution anatomique supérieure au scanner. Elle distingue mieux les différentes structures cérébrales et permet de mesurer précisément la taille, la localisation et l’étendue de la lésion infarcie (zone cérébrale nécrosée).
Grâce à ses multiples séquences, l’IRM distingue les tissus « anormaux ». Par exemple, les séquences pondérées T2 (ou écho de gradient) mettent en évidence la présence de sang ou de micro-saignements, signe d’une éventuelle hémorragie. Néanmoins, la détection initiale d’une hémorragie massive reste plus rapide au scanner.
Délai optimal pour réaliser une IRM après un AVC ischémique
Si l’établissement dispose d’un plateau technique IRM 24 h/24, il est préférable de réaliser immédiatement une IRM cérébrale (dans les 6 premières heures) pour guider la thrombolyse ou la thrombectomie.
Si l’IRM n’est pas disponible en urgence, on effectue d’abord un scanner pour exclure l’hémorragie, puis on réalise l’IRM secondairement (dans les 24 h) afin de compléter le bilan et affiner l’orientation thérapeutique.
Rôle de l’IRM dans la prise en charge de l’AVC ischémique
Rechercher les causes de l’AVC ischémique
L’IRM permet de confirmer le caractère ischémique de l’accident après avoir éliminé la présence d’une hémorragie.
L’angio-IRM (angiographie par IRM) explore les artères du cou et du cerveau pour identifier la cause de l’AVC. Elle peut révéler :
→ une dissection d’une artère cervicale (formation d’un hématome dans la paroi vasculaire) ;
→ une sténose athéroscléreuse (rétrécissement par plaque) souvent à la carotide interne ;
→ une occlusion persistante d’un gros vaisseau ;
→ d’autres anomalies de la circulation intracrânienne (malformations, malposition artérielle, etc.).
Orienter la décision thérapeutique en urgence
En combinant les images de diffusion et de perfusion, l’IRM délimite la zone nécrosée (cœur de l’infarctus) et la pénombre ischémique, encore viable. Ce « mismatch » entre diffusion et perfusion indique les tissus récupérables. L’évaluation du cœur ischémique et de la pénombre aide à décider du traitement.
La thrombolyse intraveineuse consiste à administrer, par voie veineuse ou artérielle, un médicament destiné à dissoudre le caillot qui bouche un vaisseau sanguin. Elle reste possible jusqu’à environ 4 h 30 après le début des symptômes.
La thrombectomie mécanique consiste à retirer le caillot qui obstrue une artère cérébrale. Pour cela, un cathéter est introduit au niveau de l’aine, puis guidé jusqu’au vaisseau bouché. Le caillot est alors capturé à l’aide d’un stent (un petit dispositif métallique en forme de cylindre) avant d’être extrait, rétablissant ainsi la circulation sanguine. Elle est recommandée dans les 6 heures qui suivent l’AVC. Des données indiquent toutefois qu’elle pourrait encore être bénéfique jusqu’à 24 heures après l’accident, dans certaines conditions.
L’angio-IRM évalue les artères intra- et extracrâniennes pour localiser précisément l’occlusion ou la sténose à traiter. Cette localisation détermine le geste (thrombectomie mécanique ciblant le vaisseau bouché) et la suite de la prise en charge.
Évaluer le pronostic et prévenir les complications de l’AVC ischémique
L’IRM en phase aiguë donne aussi des indices pronostiques. Elle quantifie le volume du cœur ischémique et révèle le profil de la lésion.
Par exemple, un infarctus très étendu (cœur ischémique volumineux) sans pénombre (appelé « profil radiologique malin ») est associé à un mauvais pronostic. En revanche, un important « mismatch » est de bon pronostic clinique.
L’IRM identifie précocement les complications. La détection d’un œdème cérébral infraclinique ou de micro-hémorragies signale un risque d’aggravation (engagement cérébral ou saignement de reperfusion). Ces informations permettent d’adapter la surveillance (par exemple, soins intensifs ou décompression).
Intérêt de l’IRM dans le suivi post-AVC
Surveiller l’évolution des lésions de l’AVC
L’IRM de contrôle, réalisée plusieurs semaines après l’AVC, distingue les zones définitivement nécrotiques des tissus qui ont récupéré. Un infarctus ancien apparaît alors comme une zone liquidienne (gliose). Elle confirme ainsi l’évolution cicatricielle de l’infarctus.
L’apparition de crises d’épilepsie post-AVC motive souvent la réalisation d’une IRM de suivi pour visualiser la cicatrice corticale associée.
La séquence FLAIR de l’IRM permet également de repérer les séquelles plus anciennes et les lésions chroniques associées, comme la leucoaraïose (atteinte du système nerveux central liée à des troubles de la microcirculation cérébrale, facteur de risque majeur d’AVC ischémique).
LIRE AUSSI : IRM cérébrale : déroulement et applications
Anticiper les séquelles et guider la rééducation après l’AVC
La connaissance précise de l’étendue et de la localisation des lésions cérébrales oriente la rééducation. Par exemple, un AVC touchant le cortex moteur entraîne une rééducation motrice intensive, tandis qu’un AVC affectant les aires langagières impose une rééducation orthophonique.
L’IRM (en analyse statique ou fonctionnelle) permet d’identifier les zones intactes qui peuvent compenser les fonctions perdues. Ces données facilitent l’adaptation du programme de rééducation (motrice, cognitive, langage) à chaque patient.
Mettre en place une prévention secondaire et éviter les risques de récidive d’AVC
En révélant l’étiologie (les causes) de l’AVC ischémique, l’IRM participe directement au choix du traitement préventif :
→ antiagrégants plaquettaires en cas d’athérosclérose ;
→ anticoagulants en cas d’embolie cardiaque ;
→ chirurgie ;
→ angioplastie carotidienne ;
→ fermeture du foramen ovale…
L’IRM aide ainsi à adapter les traitements pour réduire fortement le risque de récidive.
Dépister les récidives d’AVC grâce à l’IRM cérébrale
L’IRM est extrêmement sensible pour détecter de nouveaux infarctus cérébraux, y compris lorsqu’ils sont cliniquement silencieux et auraient pu passer inaperçus au scanner.
Elle permet aussi de dater les lésions. Par exemple, un foyer visible en diffusion, mais totalement absent en FLAIR, indique un AVC très récent (moins de 4 h 30).
Au-delà de son rôle diagnostique en phase aiguë de l’AVC ischémique, L’IRM influence toutes les étapes thérapeutiques et de suivi. Les avancées récentes, grâce à l’IRM 7T, promettent d’affiner encore davantage cette stratégie. La clé pour l’avenir reste l’amélioration de l’accès précoce à l’imagerie et la prévention (primaire et secondaire) des AVC, afin de réduire leur incidence et leurs séquelles.
⏩ Pour mieux comprendre les progrès de l’imagerie cérébrale dans les maladies neurologiques, découvrez le projet Huma IRM 7T porté par la Fondation HCL.
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
• Imagerie par résonance magnétique (IRM) en cas de troubles neurologiques – Le Manuel MDS
• Imagerie de perfusion en phase aiguë de l’AVC – Revue médicale suisse
• Le diagnostic et le traitement – L’accident vasculaire cérébral – HUG
• Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke – the American Stroke Association
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.