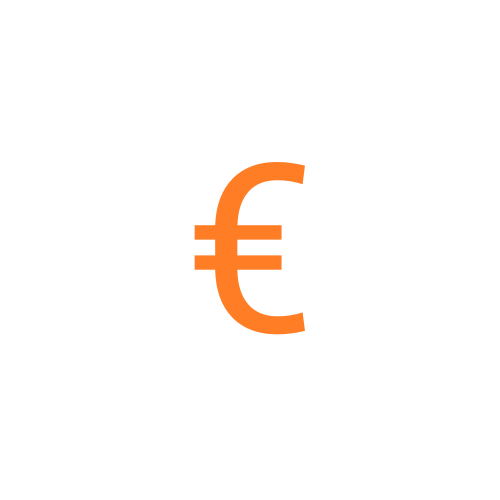Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » IRM 7 Tesla et troubles du neuro-développement (TND)
IRM 7 Tesla et troubles du neuro-développement (TND)
Parce qu’elle améliore considérablement la résolution spatiale et donc l’accès à une imagerie de très haute résolution, l’IRM 7 Tesla présente un intérêt majeur dans le champ des troubles du neuro-développement, tant en termes de diagnostic et de pronostic, qu’en termes de prise en charge précoce ou de suivi de l’efficacité des traitements.
Les explications du Pr Vincent Des Portes, chef du service de neuropédiatrie, et du Dr Aurore Curie, neuropédiatre – Hôpital Femme Mère Enfant.
« Grâce à la résolution spatiale considérablement améliorée, les images de l’IRM 7T nous rapprochent de plus en plus d’une coupe anatomique d’un cerveau, avec ses différentes couches. On voit, par exemple, la limite entre la substance blanche et la substance grise, entre les axones (les « câbles » qui permettent aux neurones de communiquer entre eux) et les neurones (qui constituent le cortex cérébral et les noyaux gris centraux)… Or certaines pathologies du neuro-développement impactent l’une ou l’autre de ces structures.
Par exemple, pour certaines formes d’épilepsie, dont l’origine est dans les neurones du cortex cérébral, l’IRM 7T présente un intérêt majeur. Chez certains adolescents qui sont traités depuis l’enfance pour une épilepsie précoce et n’ont plus de crise depuis des années, on voudrait arrêter les médicaments antiépileptiques. Avant cela, on vérifie qu’il n’y a pas d’anomalie, comme une dysplasie corticale, dont la présence inciterait à une grande prudence car quand on arrête les médicaments, parfois l’épilepsie reflambe et on ne parvient plus à revenir à l‘état antérieur. Or, des études montrent que l’IRM 7T augmente de 20 à 30% la détection de dysplasies par rapport à une IRM 3T, actuellement utilisée.
Un autre exemple, celui du cervelet, ce « petit cerveau » caché en bas et à l’arrière du cerveau, qui est un coprocesseur de l’apprentissage. Il existe des variations anatomiques en fonction des individus, et on a parfois du mal à caractériser précisément les malformations. Est-ce qu’on a affaire à une malformation ? Ou à une structure normale un peu refoulée par un kyste ? Faire la différence est important pour le pronostic. Une meilleure résolution spatiale devrait permettre d’avoir une analyse plus fine de structures qui ont été abîmées (par un virus, une hémorragie), ou de structures qui ne se sont pas formées du tout pour des raisons génétiques.
L’IRM 7T permettra donc de voir encore plus précisément l’anatomie du cerveau. Mais ce que l’on sait moins, c’est que l’on pourra également avoir une idée très précise du fonctionnement du cerveau, au niveau cellulaire. On pourra analyser, au cœur du cerveau, un grand nombre de molécules biochimiques, avec, là encore, un enjeu diagnostic.
C’est comme si on faisait une prise de sang pour doser des substances chimiques, mais au lieu de faire ce dosage dans le sang, on le fait directement dans les structures cérébrales. Par exemple, face à un déficit en transporteur de créatine (maladie génétique responsable d’un handicap intellectuel et d’’autisme), on sait qu’une prise de sang est inutile parce que le taux de créatine dans le sang est normal. On peut déjà détecter ce pic avec des séquences de spectroscopie sur les IRM actuelles. Mais avec l’IRM 7T, on va pouvoir visualiser beaucoup plus finement le pic de créatine et quantifier ce pic, ce qui peut être utile comme biomarqueur d’efficacité de traitements innovants dont le but serait de restituer un taux de créatine proche de la normale.
Au-delà de cet exemple, l’IRM de très haut champ pourrait avoir sa place dans l’analyse de l’effet de médicaments dans de nombreuses pathologies, en analysant tout un spectre de substances chimiques ou neuromédiateurs non détectables sur les IRM actuelles. Pouvoir démontrer qu’un traitement a une efficacité en s’appuyant sur des biomarqueurs, c’est fondamental, car cela démontre directement un effet dans le cerveau, ce qui est un enjeu particulièrement fort pour les thérapies innovantes.
L’IRM 7T va également permettre de faire des ponts entre la génétique et les lésions acquises. On a tendance à classer les maladies génétiques d’un côté et les causes acquises (inflammatoires, auto-immunes) de l’autre. Mais aujourd’hui on s’aperçoit de plus en plus qu’il y a des ponts entre tout cela. Mieux analyser les lésions cérébrales et leur composition chimique aura certainement un impact sur le choix des traitements et l’évaluation du pronostic.
Donc ce type d’imagerie, qui sera accessible dans un premier temps aux grands enfants et aux adolescents, présente un réel intérêt pour adopter précocement la bonne stratégie diagnostique et thérapeutique.«