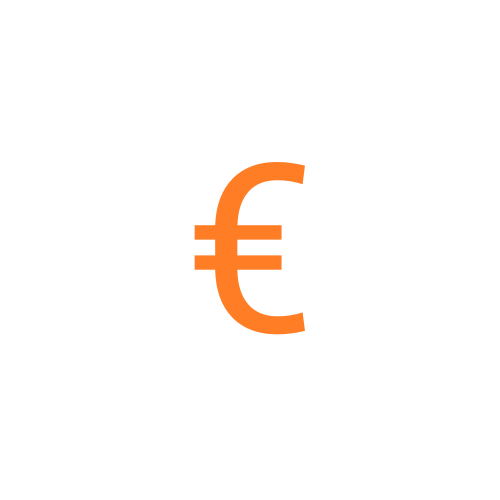Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » Épilepsie infantile et troubles associés : où en est la recherche ?
L’épilepsie infantile et ses troubles associés représentent un véritable défi, en neurologie pédiatrique. En France, entre 600 000 et 800 000 personnes reçoivent un suivi médical pour des crises épileptiques, quel que soit leur âge. Les avancées de la recherche explorent plus d’une cinquantaine de formes cliniques différentes, soulignant la diversité des épilepsies. On fait le point sur les progrès scientifiques, de la compréhension des mécanismes neuronaux aux nouvelles approches thérapeutiques, pour mieux accompagner les enfants concernés et leurs familles.
Épilepsie infantile : les troubles associés fréquents
Troubles cognitifs et d’apprentissage
Les enfants atteints d’épilepsie présentent fréquemment des troubles cognitifs complexes qui affectent leur développement. Les difficultés mnésiques (de mémorisation) représentent une problématique centrale, résultant de l’interaction entre plusieurs facteurs.
Les crises épileptiques provoquent des épisodes d’inattention rendant impossible l’encodage d’informations, tandis que les traitements anticonvulsivants, bien qu’essentiels pour réduire la fréquence des crises, peuvent induire des effets secondaires comme la somnolence et l’hyperactivité.
La fatigue chronique et les facteurs émotionnels, notamment le stress et l’anxiété, amplifient ces difficultés attentionnelles.
Les fonctions exécutives sont également altérées, se manifestant par des faiblesses dans l’organisation, la planification et la résolution de problèmes. Cette dysfonction exécutive entrave la flexibilité cognitive et l’accès à la pensée abstraite, limitant l’autonomie des enfants.
Les troubles d’apprentissage touchent jusqu’à 60 % des patients selon la localisation épileptique. L’activité électrique anormale interfère avec l’élagage neuronal naturel, maintenant des connexions superflues qui compliquent l’accès à l’information, particulièrement dans les zones temporales, frontales et occipitales.
Troubles neuro‑développementaux
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) représente une comorbidité (trouble associé) fréquente chez les enfants épileptiques, survenant plus souvent que dans la population générale.
Ce trouble se caractérise par :
→ des difficultés de concentration ;
→ une distractibilité excessive aux stimuli environnants ;
→ des troubles de l’attention soutenue lors des conversations ;
→ une volubilité marquée ;
→ des oublis récurrents ;
→ une impulsivité, particulièrement prononcée dans les formes hyperactives.
Plusieurs facteurs expliquent cette association entre épilepsie et TDA/H. L’activité épileptique elle-même perturbe les réseaux cérébraux et entrave le développement neural, particulièrement lorsque les crises surviennent tôt dans la vie.
Par ailleurs, les médicaments antiépileptiques génèrent parfois des symptômes similaires à ceux du TDA/H, créant une confusion diagnostique entre effets secondaires médicamenteux et véritable trouble attentionnel.
Le trouble du spectre de l’autisme représente une autre comorbidité importante, avec des taux particulièrement élevés dans certaines formes épileptiques.
Le syndrome de West (type d’épilepsie rare, aussi appelé « spasmes infantiles ») présente une corrélation remarquable avec l’autisme dans 46 % des cas.
L’épilepsie débutant durant la première année de vie augmente le risque d’apparition de troubles autistique à 14 %. Cette association complexe semble liée à des mutations génétiques communes et impacte considérablement le pronostic développemental.
Troubles psychiatriques
La dépression représente le trouble psychiatrique le plus fréquent chez les enfants épileptiques, touchant tous les groupes d’âge. Cette pathologie dépasse largement la simple tristesse passagère, engendrant une perte durable de plaisir pour les activités habituellement appréciées et une tristesse persistante.
Les crises mal contrôlées et complexes augmentent directement le risque. L’environnement psychosocial influence également cette vulnérabilité, notamment les antécédents familiaux de dépression, la qualité des relations parent-enfant, la surprotection et l’exposition au stress chronique. Certains anticonvulsivants, comme le Phénobarbital et la Vigabatrine, peuvent également favoriser ces troubles de l’humeur.
L’anxiété affecte 15 à 20 % des enfants épileptiques, alimentée principalement par l’imprévisibilité des crises et l’appréhension du jugement social. Cette anxiété se manifeste par une détresse disproportionnée face aux situations non menaçantes, une hypervigilance constante et des symptômes somatiques marqués.
L’adolescence et les crises d’absence semblent particulièrement propices à son développement, amplifié par les difficultés d’apprentissage et la stigmatisation associés à l’épilepsie.
Troubles somatiques
L’épilepsie infantile s’accompagne souvent de troubles physiques multiples, notamment des migraines, une perturbation du sommeil, une fatigue persistante et des complications cardiovasculaires.
Les traitements antiépileptiques portent une lourde responsabilité dans l’apparition de ces comorbidités, leurs effets secondaires étendus générant de nombreux symptômes physiques. Néanmoins, ces médicaments demeurent indispensables, car ils permettent de contrôler les crises, généralement plus invalidantes que les effets secondaires eux-mêmes.
Les crises contribuent également aux troubles somatiques en provoquant des céphalées intenses et en augmentant le risque de blessures. Un dialogue constant avec l’équipe médicale reste essentiel pour adapter le traitement lorsque les effets secondaires deviennent trop handicapants.
Épilepsie infantile : les avancées de la recherche
Exploration des mécanismes sous-jacents de l’épilepsie
La recherche génétique a permis d’identifier plus d’une centaine de gènes liés à l’épilepsie, révélant que, si certaines formes résultent de mutations monogéniques ou de novo (spontanée), la majorité présente une origine polygénique complexe.
L’utilisation de microélectrodes intracérébrales chez les patients résistants aux traitements révolutionne notre compréhension de l’activité neuronale lors des crises et des phases intercritiques. Cette technique éclaire les processus d’épileptogenèse (formation des réseaux cérébraux épileptiques) et d’ictogenèse (déclenchement des crises). Elle aide à établir les liens entre dysfonctionnements cellulaires et manifestations cliniques.
Une autre piste prometteuse concerne le métabolisme énergétique cérébral. Des chercheurs explorent comment les défaillances bioénergétiques des synapses, grandes consommatrices d’énergie, contribuent aux crises épileptiques.
L’IRM 7 Tesla ouvre des perspectives prometteuses, en permettant la visualisation des flux métaboliques, notamment sodiques. Cette technique d’imagerie offre de nouveaux marqueurs pour identifier les foyers épileptiques et enrichit notre vision multifactorielle de cette pathologie complexe.
Diagnostic et pronostic de l’épilepsie : outils et enjeux
Le diagnostic de l’épilepsie infantile est parfois difficile, en raison de la diversité des anomalies cérébrales susceptibles de générer des crises. Les malformations corticales mineures échappent souvent au diagnostic, leur détection étant entravée par un contraste insuffisant avec le tissu cérébral sain. L’évaluation de l’étendue lésionnelle reste également problématique, les limites anatomiques étant souvent floues à l’imagerie conventionnelle.
L’IRM 7 Tesla ouvre de nouvelles perspectives grâce à sa résolution spatiale supérieure et son contraste tissulaire optimisé, permettant une meilleure exploration lésionnelle.
L’intelligence artificielle pourrait également révolutionner ce domaine, en détectant des anomalies subtiles échappant à l’analyse radiologique traditionnelle, notamment par comparaison avec des bases de données d’imagerie 7T de référence, et en prédisant l’efficacité thérapeutique des interventions chirurgicales.
Innovations thérapeutiques concernant l’épilepsie infantile
L’arsenal thérapeutique actuel comprend une vingtaine d’antiépileptiques, qui modulent la transmission synaptique et limitent la diffusion des crises. Ils permettent un contrôle satisfaisant chez 60 à 70 % des patients.
La recherche développe activement de nouvelles molécules, qu’il s’agisse de repositionnements thérapeutiques issus d’autres pathologies neurologiques ou de composés inédits ciblant les mécanismes synaptiques. Cependant, ces approches restent symptomatiques sans s’attaquer aux causes primaires de l’épileptogenèse.
Face aux 30 % d’épilepsies pharmaco-résistantes, la chirurgie demeure la seule option curative. Le succès chirurgical dépend essentiellement de la localisation précise des foyers épileptogènes par IRM cérébrale, complétée si nécessaire par des explorations intracérébrales invasives limitées à 15 électrodes maximum.
L’IRM 7 Tesla représente un espoir considérable pour améliorer la détection lésionnelle et optimiser les résultats chirurgicaux, qui permettent actuellement une amélioration dans 60 à 70 % des cas.
La recherche sur l’épilepsie infantile et ses troubles associés progresse, même si de nombreux défis restent à relever. Mieux comprendre ces pathologies permet d’adapter les prises en charge et d’améliorer la qualité de vie des enfants concernés.
⏩ Envie de comprendre comment l’IRM 7 T pourrait repérer des lésions invisibles jusqu’ici ? Jetez un œil au projet Huma 7T.
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
• Principaux repères sur l’épilepsie – OMS
• Comorbidités : Parlons d’épilepsie – CHU Sainte-Justine
• Conséquences cognitives : Parlons d’épilepsie – CHU Sainte-Justine
• Épilepsie : les avancées de la recherche sur une maladie mystérieuse – Cortex Mag
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.