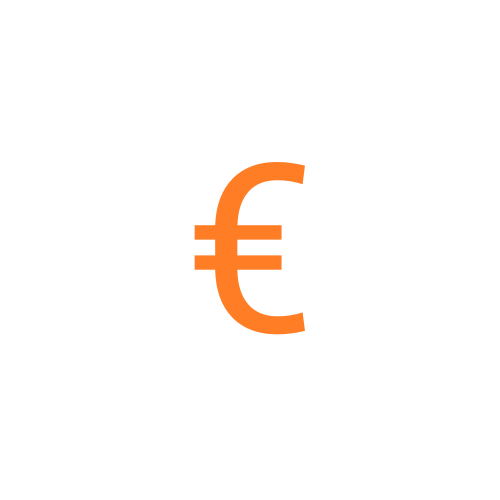Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » IRM et AVC : Un outil essentiel pour le diagnostic
Une personne de votre entourage présente soudain des troubles de la parole ou une paralysie d’un côté ? Vous pensez aussitôt à un AVC. L’IRM est l’imagerie médicale de référence, pour comprendre ce qu’il se passe dans le cerveau. Mais que peut-elle vraiment montrer ? Permet-elle d’éviter les séquelles ? On vous explique comment l’IRM aide à poser le bon diagnostic et à prendre les bonnes décisions en urgence.
AVC et IRM : que montre l’imagerie en cas d’accident vasculaire cérébral ?
Le cerveau dépend d’un flux constant d’oxygène et de glucose pour fonctionner. Contrairement à d’autres organes, il ne dispose d’aucune réserve. Si ce flux est interrompu, même brièvement, certaines zones cérébrales commencent à souffrir. La gravité des lésions dépend alors des voies de suppléance artérielle disponibles.
Lorsqu’un infarctus cérébral survient, deux zones se dessinent à l’IRM :
→ une zone centrale, où les cellules meurent rapidement ;
→ une zone périphérique dite « pénombre », qui peut encore être sauvée si la circulation est rétablie à temps.
Le « mismatch diffusion‑perfusion » correspond justement à la différence entre la zone cérébrale à risque (déficit de perfusion) et le cœur de l’infarctus (zone de restriction de diffusion). Il permet d’identifier les tissus encore récupérables et donc éligibles à une intervention rapide.
Grâce à l’IRM, il est possible d’identifier l’origine de l’accident vasculaire, ce qui oriente immédiatement la prise en charge :
→ un AVC ischémique, dû à l’obstruction d’une artère cérébrale par un caillot ;
→ ou un AVC hémorragique, qui résulte de la rupture d’un vaisseau entraînant un saignement directement dans le cerveau.
Cette imagerie peut également repérer les séquelles d’un AVC ancien, ce qui est utile pour comprendre des troubles persistants ou poser un diagnostic rétrospectif.
Quelles sont les séquences d’IRM pour les AVC ?
Diffusion (DWI)
L’IRM de diffusion permet de visualiser très précocement l’infarctus cérébral. En cas d’ischémie, les mouvements de l’eau intracellulaire sont altérés. Cette atteinte est mesurée par une baisse du coefficient apparent de diffusion (ADC), qui apparaît en noir sur les images.
Cette séquence met en évidence la zone infarcie (tissus nécrosés) en seulement quelques minutes. Elle sert aussi à mesurer son volume et détecter un éventuel « mismatch » entre les signes cliniques et l’image, critère important pour envisager un traitement endovasculaire au-delà des 6 premières heures.
FLAIR
La séquence FLAIR (Fluid Attenuated Inversion-Recovery) est utile pour visualiser les AVC constitués depuis plus de 6 heures. Elle permet également de repérer les AVC plus anciens ou certaines lésions chroniques, comme les leucoencéphalopathies.
Si une anomalie est visible en diffusion mais pas en FLAIR, on parle de « mismatch FLAIR-diffusion », un indicateur précieux d’un AVC datant de moins de 4 h 30. Cette information influence directement l’indication pour une thrombolyse.
Le FLAIR est donc essentiel à la fois pour dater l’AVC et identifier d’éventuelles atteintes vasculaires passées.
T2 (ou écho de gradient)
Le T2 est sensible aux dépôts de sang dans le cerveau. Il détecte les hématomes récents, les micro-saignements (microbleeds), mais aussi les thrombus intra-artériels. Il complète les autres séquences en apportant une information sur la composante hémorragique éventuelle.
La perfusion, souvent associée à cette séquence, montre la zone hypoperfusée. En comparant les images de diffusion et de perfusion, on identifie la pénombre cérébrale, cible des traitements de reperfusion. Bien que cette séquence ne soit pas systématique en urgence, elle est souvent précieuse dans la stratégie thérapeutique.
Angiographie cérébrale par résonance magnétique (ARM ou angio-IRM)
L’angio-IRM permet d’observer les vaisseaux cérébraux sans injection de produit de contraste grâce à la séquence TOF (Time of Flight).
Il permet de détecter une éventuelle occlusion et visualise le polygone de Willis. Cet ensemble de petites artères, formant une boucle à la base du cerveau, peut limiter les dommages cérébraux si une artère est bouchée, en redistribuant le sang via les artères communicantes.
Ce type d’imagerie complète l’analyse du cerveau, en regardant aussi les principales artères du cou et de la tête, ce qui permet de repérer un caillot ou un rétrécissement de ces vaisseaux.
L’angio-IRM permet ainsi de localiser la cause de l’AVC et de guider les traitements endovasculaires.
Quels sont les avantages de l’IRM dans la prise en charge des AVC ?
Précision et rapidité du diagnostic
L’IRM est aujourd’hui l’examen de référence pour poser un diagnostic rapide et fiable en cas d’AVC. Sa sensibilité est bien plus élevée que celle du scanner, notamment dans les premières heures, où chaque minute compte. Elle permet de visualiser très tôt la zone touchée par l’infarctus, souvent dès les premières minutes.
Grâce à l’IRM multimodale, plusieurs séquences sont combinées pour dresser un bilan complet :
→ diffusion (1 min) ;
→ FLAIR (3 min 30 s) ;
→ T2 (2 min) ;
→ angio-IRM du polygone de Willis (4 min 40 s) ;
→ dans certains cas, une séquence de perfusion peut aussi être ajoutée (1 min).
Ce « protocole vasculaire » peut donc être réalisé en seulement douze minutes, en contexte d’urgence !
L’imagerie permet de localiser précisément l’infarctus, d’estimer l’étendue de la zone à risque, et d’identifier le fameux mismatch ischémie-pénombre, essentiel pour prolonger la fenêtre thérapeutique au-delà des six heures habituelles.
À l’avenir, les progrès de l’intelligence artificielle pourraient encore raccourcir les délais d’analyse. Des logiciels automatisent désormais la détection du noyau infarci et du volume hypoperfusé. Le développement d’IRM ultra-haute résolution (IRM 7T) promet quant à lui d’améliorer encore davantage la précision des images.
Impact sur le traitement et la récupération
Mais l’IRM n’est pas seulement utile pour poser un diagnostic. Elle aide aussi à orienter le traitement. Elle permet de distinguer un AVC ischémique, indicatif pour une thrombolyse ou thrombectomie, d’un AVC hémorragique.
Elle évalue aussi la taille des lésions, leur évolution et leur impact probable. Comme l’IRM ne délivre pas de rayons, elle peut être répétée sans risque, ce qui est précieux pour surveiller les séquelles, les éventuelles récidives ou suivre la récupération du cerveau. C’est donc un outil complet, du diagnostic au suivi.
L’IRM permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau en cas d’AVC et d’agir rapidement. Elle fait aujourd’hui partie des outils indispensables pour sauver des neurones. Face à un doute, chaque minute compte : mieux vaut consulter sans attendre.
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
• Accidents vasculaires cérébraux | www.cen-neurologie.fr
• Bracard, S., Carsin, M., Cattin, F., De Bray, J. M., Depriester, C., Hommel, M.,… & Sadick, J. C. (2002). Imagerie de l’accident vasculaire cérébral aigu. Service évaluation des technologies. Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES).
• Cho, T. H., Pialat, J. B., Hermier, M., Derex, L., & Nighoghossian, N. (2009). Imagerie par résonance magnétique multimodale dans la prise en charge en urgence des accidents ischémiques cérébraux.
• Xiong, Y., Luo, Y., Wang, M., Yang, S. T., Shi, R., Ye, W., … & Wang, Y. (2022). Evaluation of Diffusion–Perfusion Mismatch in Acute Ischemic Stroke with a New Automated Perfusion-Weighted Imaging Software: A Retrospective Study. Neurology and therapy, 11(4), 1777-1788.
• David A, Boulenc E, Martin M, Nueffer JP, Bonneville JF, Rôle de l’IRM dans la prise en charge de l’ischémie cérébrale aiguë à l’ère de la thrombolyse et de la thrombectomie, CHU de Besançon.
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.