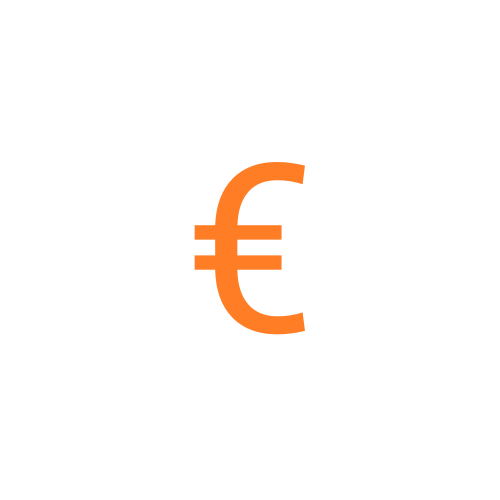Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » Quels sont les leviers pour ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer ?
Face à un trouble qui altère la mémoire et l’autonomie, beaucoup se demandent comment ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer ? Existe-t-il vraiment des leviers efficaces au quotidien ? Entre prévention, hygiène de vie et traitements, plusieurs pistes concrètes permettent aujourd’hui d’agir pour préserver plus longtemps les fonctions cognitives.
Comprendre l’évolution de la maladie d’Alzheimer
Des années avant les premiers signes cliniques, le cerveau présente déjà des dépôts de bêta-amyloïde, des enchevêtrements de protéine Tau et des signes d’inflammation. Leur détection précoce permettrait de mieux suivre la maladie et d’agir plus efficacement sur son évolution.
Est-ce que la maladie d’Alzheimer évolue vite ?
Après l’apparition des premiers symptômes, la maladie d’Alzheimer évolue en moyenne sur une dizaine d’années.
L’espérance de vie après diagnostic dépend de l’âge :
→ environ 12 à 14 ans dans le cas d’un diagnostic précoce (60-65 ans) ;
→ 7 à 10 ans chez les personnes diagnostiquées entre 70 et 80 ans ;
→ 3 à 7 ans après 80 ans.
L’évolution dépend aussi de quelle fonction décline (mémoire, autonomie, langage…), car toutes ne se détériorent pas au même rythme.
Des comorbidités ou complications (infections, chutes, dénutrition…) peuvent brusquement intensifier le déclin.
Quels sont les stades de la maladie d’Alzheimer ?
L’échelle de détérioration globale (Reisberg, 1982) décrit 7 stades de la maladie :
1. Aucun déficit cognitif : fonctions normales, mémoire intacte.
2. Très léger : petits oublis occasionnels, souvent confondus avec le vieillissement.
3. Léger : difficultés à trouver ses mots, désorganisation, baisse de performance perceptible.
4. Modéré : oublis fréquents, perte d’autonomie dans les tâches complexes (gestion financière, planification).
5. Modérément sévère : besoin d’aide au quotidien, désorientation, troubles du jugement.
6. Sévère : dépendance accrue, altérations du comportement, incontinence.
7. Très sévère : perte de communication, mobilité réduite, dépendance totale. La progression s’accélère généralement aux stades avancés.
Facteurs influençant la progression de la maladie d’Alzheimer
Plusieurs éléments influencent la vitesse de progression de la maladie. L’âge est un facteur déterminant. Plus le diagnostic survient tard, plus la progression tend à s’accélérer, en raison d’une moindre « réserve » cognitive et de comorbidités associées.
Les femmes sont davantage touchées, probablement sous l’influence de mécanismes hormonaux ou génétiques.
Le gène APOE ε 4 augmente à la fois le risque et la rapidité d’évolution, tandis que certaines mutations génétiques rares (APP, PSEN 1, PSEN 2) entraînent des formes précoces.
Le syndrome de Down, les traumatismes crâniens ou d’autres lésions cérébrales favorisent aussi une aggravation plus rapide.
Cependant, d’autres facteurs, liés au mode de vie ou à la santé globale, sont modifiables et offrent de réels leviers d’action.
Comment ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer grâce à la prévention ?
Les leviers pour ralentir l’évolution de la maladie sont souvent les mêmes que ceux mis en avant pour la prévention, et reposent sur l’adoption d’habitudes favorables à la santé cérébrale et globale.
Pratiquer une activité physique régulière
L’exercice aérobique (marche rapide, natation, vélo) améliore la circulation sanguine, protège le système vasculaire et stimule l’activité cérébrale.
Il contribue à réduire le risque de démence, freine l’accumulation de protéines toxiques et aide à maintenir le volume de l’hippocampe (région du cerveau impliquée dans la mémoire et l’apprentissage).
Même une activité modérée, pratiquée régulièrement, a un effet positif sur la mémoire et les fonctions exécutives.
Adopter une alimentation équilibrée et protectrice du cerveau
Les régimes méditerranéen, DASH ou le régime MIND ont montré un effet protecteur.
Riches en fruits, légumes, céréales complètes, poissons et légumineuses, tout en limitant sucres, graisses saturées et viandes transformées, ce mode alimentaire ralentit le déclin cognitif, soutient la santé cardiovasculaire et réduit l’inflammation, facteurs clés dans Alzheimer.
Prévenir et contrôler les facteurs vasculaires et métaboliques
Contrôler l’hypertension est essentiel, car une tension élevée endommage les vaisseaux cérébraux et diminue le flux sanguin vers le cerveau.
Gérer le diabète ou une glycémie élevée limite le stress oxydatif et l’inflammation, nocifs pour les neurones.
Maintenir un poids santé et surveiller le cholestérol (notamment le LDL) aide à éviter les atteintes vasculaires qui accélèrent la progression.
Stimuler ses capacités cognitives au quotidien
S’exercer mentalement en apprenant de nouvelles compétences (une langue, un instrument de musique, du théâtre…), pratiquer des jeux de réflexion ou résoudre des puzzles aide à entretenir les circuits neuronaux.
Les entraînements cognitifs structurés (programmes de remémoration, ateliers mémoire, etc.) montrent aussi qu’ils peuvent préserver certaines fonctions comme le raisonnement, la mémoire de travail, ou le raisonnement abstrait.
Maintenir une vie sociale active et enrichissante
Les relations sociales, les échanges, les activités collectives apportent une stimulation mentale, mais aussi un soutien émotionnel.
L’isolement est un facteur de risque identifié. Participer à des activités de groupe, à des clubs, à des loisirs partagés aide à maintenir les capacités cognitives, à limiter la solitude et le stress.
Favoriser un sommeil réparateur et de qualité
Le sommeil permet au cerveau de consolider les souvenirs, d’éliminer les toxines (comme la bêta-amyloïde) et de réparer les dommages métaboliques.
Des troubles du sommeil (insuffisance, fragmentation, apnées) sont liés à une progression plus rapide de déficits cognitifs. Améliorer l’hygiène du sommeil (horaires réguliers, environnement propice, pas d’écrans tardifs, etc.) peut aider.
Corriger les troubles sensoriels
Une perte auditive non corrigée augmente le stress cognitif et l’isolement social, contribuant à un déclin plus rapide des fonctions cérébrales.
Dès qu’un déficit est identifié, le corriger à l’aide d’appareils auditifs offre un levier concret pour ralentir le risque de progression vers la démence.
Réduire le tabac et limiter la consommation d’alcool
Le fait de fumer et boire beaucoup accélère le déclin cognitif. Le tabac provoque un stress oxydatif, des lésions vasculaires et endommage les neurones, ce qui favorise Alzheimer.
Quant à l’alcool, une consommation importante sur le long terme altère la structure du cerveau, accélère la perte de fonctions cognitives, et augmente le risque de démence.
Prendre en charge le stress et la dépression
Des études montrent que des niveaux élevés de stress prolongé peuvent accélérer la perte cognitive, notamment via l’augmentation du cortisol et l’inflammation cérébrale qui endommagent l’hippocampe.
La dépression, surtout lorsqu’elle persiste, est liée à une évolution plus rapide vers des phases sévères de la maladie. Traiter à temps ces troubles peut réduire leur impact délétère sur le cerveau.
Les traitements disponibles pour ralentir la progression d’Alzheimer
Un diagnostic précoce ouvre la porte à une intervention plus efficace, ralentissant sensiblement la progression.
Les inhibiteurs de la cholinestérase : améliorer la transmission neuronale
Les médicaments comme le donepezil, la galantamine ou la rivastigmine visent à augmenter la quantité d’acétylcholine dans le cerveau, ce qui améliore la communication entre les neurones.
Bien qu’ils n’arrêtent pas la maladie, ils peuvent modérer les symptômes cognitifs légers à modérés, retarder le besoin d’aides et offrir une meilleure qualité de vie pendant plusieurs mois à années.
La mémantine pour les stades modérés à sévères
La mémantine agit sur les récepteurs NMDA, régulant l’effet du glutamate pour limiter l’excitotoxicité neuronale.
Elle est utilisée quand Alzheimer est déjà modéré à sévère, souvent en association avec un inhibiteur de la cholinestérase. Elle aide à stabiliser ou ralentir le déclin dans la mémoire, le langage ou les fonctions quotidiennes pour certains patients.
Les traitements antiamyloïdes : avancées et perspectives
Les anticorps monoclonaux tels que le lecanemab et le donanemab ciblent les amas d’amyloïde dans le cerveau.
Dans des essais cliniques, le lecanemab a montré une réduction des marqueurs amyloïdes et un ralentissement modéré du déclin cognitif chez des personnes au début de la maladie.
Le donanemab, validé dans des stades précoces, offre également des bénéfices cognitifs et fonctionnels, avec un potentiel de modifier le cours de la maladie s’il est utilisé suffisamment tôt.
Agir sur les bons leviers ne permet pas d’arrêter Alzheimer, mais peut en freiner l’évolution et préserver la qualité de vie. Et demain, les avancées de la recherche offriront peut-être de nouvelles perspectives pour renforcer encore cette lutte.
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
• Alzheimer’s: Medicines help manage symptoms and slow decline – Mayo Clinic
• Preventing Alzheimer’s Disease: What Do We Know? | National Institute on Aging
• Predictive factors for Alzheimer’s disease progression: a comprehensive retrospective analysis of 3,553 cases with 211 months follow-up
• Ferrari, C., Lombardi, G., Polito, C., Lucidi, G., Bagnoli, S., Piaceri, I., … & Sorbi, S. (2017). Alzheimer’s disease progression: factors influencing cognitive decline. Journal of Alzheimer’s Disease, 61(2), 785-791.
• Pahlavani, H. A. (2023). Exercise therapy to prevent and treat Alzheimer’s disease. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 1243869.
• Arora, S., Santiago, J. A., Bernstein, M., & Potashkin, J. A. (2023). Diet and lifestyle impact the development and progression of Alzheimer’s dementia. Frontiers in nutrition, 10, 1213223.
• Azeem, A., Julleekeea, A., Knight, B., Sohail, I., Bruyns-Haylett, M., & Sastre, M. (2023). Hearing loss and its link to cognitive impairment and dementia. Frontiers in Dementia, 2, 1199319.
• Dafsari, F. S., & Jessen, F. Depression-an underrecognized target for prevention of dementia in Alzheimer’s disease. Transl Psychiatry. 2020; 10 (1): 160.
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.