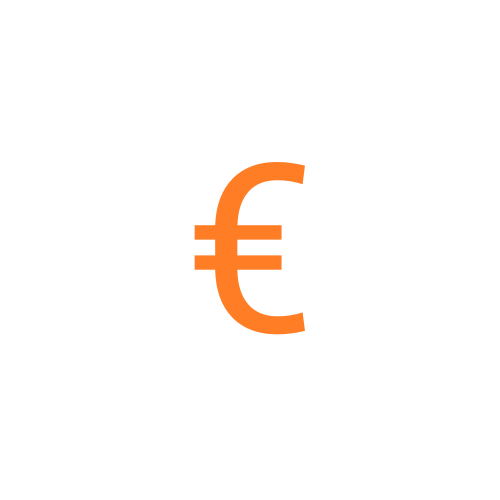Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » Les phtalates : Définition, risques et alternatives
Les phtalates, c’est quoi exactement ? Derrière ce terme se cachent des substances chimiques largement utilisées dans l’industrie du plastique, visant à améliorer la flexibilité et la durabilité des matériaux. Toutefois, leur utilisation suscite de plus en plus d’inquiétudes en raison des risques qu’ils posent pour la santé humaine et l’environnement. Précisons ensemble ce que sont les phtalates, comment ils agissent, les dangers qu’ils représentent, ainsi que les alternatives disponibles pour limiter leur impact.
Les phtalates, c’est quoi ?
Les phtalates sont des dérivés de l’acide phtalique, utilisé pour assouplir les plastiques. Leur popularité dans l’industrie repose sur leur coût relativement faible et leur efficacité pour assouplir les polymères. Leur utilité est indéniable, mais ils sont aussi très controversés en raison de leurs effets potentiels sur la santé humaine.
Structure chimique des phtalates
Les phtalates sont des composés chimiques formés à partir de la réaction entre l’acide phtalique et divers alcools. Leur structure chimique leur permet de se lier facilement aux polymères plastiques, leur conférant cette capacité à ramollir les matériaux.
Cependant, cette liaison est faible, ce qui signifie que les phtalates peuvent se détacher au fil du temps. En raison de leur nature volatile, ils peuvent migrer des objets vers l’environnement et pénétrer dans le corps humain par ingestion, inhalation ou contact cutané.
Exemples de produits contenant des phtalates
Les phtalates sont présents dans de nombreux produits de consommation courante :
- Les produits en PVC souple : revêtements de sol, rideaux de douche, jouets ;
- Les emballages alimentaires : films plastiques, contenants ;
- Les produits cosmétiques : parfums, vernis à ongles, lotions ;
- Les dispositifs médicaux : poches de perfusion, tubulures, gants médicaux ;
- Les produits automobiles : tableaux de bord, garnitures intérieures ;
- Les câbles électriques et les fils isolés ;
- Les vêtements et chaussures : impressions plastifiées, semelles ;
- Les produits d’entretien : détergents, désodorisants ;
- etc.
Cette polyvalence en fait des composés chimiques omniprésents, même dans des produits auxquels on ne penserait pas immédiatement.
Les risques des phtalates pour la santé
Les phtalates sont associés à divers risques pour la santé, en particulier parce qu’ils sont classés comme perturbateurs endocriniens. Leur capacité à interférer avec le système hormonal humain est au centre des préoccupations, en particulier pour certaines populations vulnérables.
Perturbateurs endocriniens : Quels effets sur la santé et l’environnement ?
Les phtalates sont reconnus comme des perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire qu’ils peuvent interférer dans le fonctionnement du système hormonal. Ces substances chimiques peuvent imiter, bloquer ou modifier l’action de certaines hormones dans le corps, entraînant des effets néfastes sur la santé.
Des études ont montré que l’exposition à ces composés pourrait être liée à des problèmes de fertilité, des malformations congénitales, et des troubles du développement chez les enfants.
De plus, les phtalates persistent dans l’environnement, où ils peuvent s’accumuler dans les écosystèmes et affecter la faune, en particulier les espèces aquatiques, en perturbant également leur système endocrinien.
LIRE AUSSI : Quels sont les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé ?
Populations à risque : Femmes enceintes et jeunes enfants
Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à l’exposition aux phtalates. C’est pourquoi des précautions supplémentaires sont souvent recommandées pour limiter leur contact avec les phtalates.
Chez la femme enceinte, les phtalates peuvent traverser la barrière placentaire, exposant le fœtus en développement. Cela peut entraîner des risques de malformations congénitales, notamment au niveau du système reproducteur masculin.
Le système endocrinien en développement des jeunes enfants est plus sensible aux perturbations. Malheureusement, leurs comportements (porter les objets à la bouche, ramper au sol) augmentent leur exposition. Les phtalates peuvent affecter leur croissance, leur développement cognitif et leur système immunitaire.
REPLAY : Découvrez les effets des perturbateurs endocriniens sur les bébés
Normes et réglementation
En France et en Europe, l’utilisation des phtalates est réglementée, notamment par le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Celle-ci évolue à mesure que de nouvelles données scientifiques émergent, renforçant progressivement les restrictions sur l’utilisation des phtalates.
À l’heure actuelle, plusieurs phtalates sont classés comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et sont inscrits à l’Annexe XIV du règlement REACH, ce qui signifie qu’une autorisation est nécessaire pour leur mise sur le marché européen :
- le Benzyle Butyle Phtalate (BBP) ;
- le Di (2-EthylHexyl) Phtalate (DEHP) ;
- le DiButyle Phtalate (DBP) ;
- le DiIsoButyle Phtalate (DIBP).
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) veille à l’application du règlement REACH et d’autres législations relatives aux produits chimiques.
Des labels comme « sans phtalates » ou « phtalate free » existent, mais ne sont pas officiellement réglementés. En revanche, l’Écolabel européen garantit l’absence de phtalates dans les produits certifiés.
LIRE AUSSI : Comment limiter ou éviter les perturbateurs endocriniens ?
Alternatives aux phtalates
Les chercheurs et les industries se tournent vers des alternatives pour remplacer les phtalates, tout en s’assurant que ces nouvelles substances ne posent pas de risques similaires pour la santé et l’environnement. Ces efforts sont soutenus par des tests rigoureux de toxicité et des études à long terme sur leur impact.
Plastifiants alternatifs
Parmi les plastifiants non phtalates, le DEHT est largement utilisé aux États-Unis comme alternative aux phtalates. Approuvé pour le contact alimentaire, il offre une excellente flexibilité au PVC et une bonne résistance aux basses températures.
Populaire en Europe, le DINCH est utilisé dans les jouets, équipements médicaux et emballages alimentaires. Sa structure cyclique lui confère une stabilité et une résistance à la migration supérieures. Il est approuvé par l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) pour le contact alimentaire.
Les trimellitates (TOTM) excellent en résistance à la chaleur et faible volatilité. Utilisés principalement dans les câbles électriques et revêtements de sol PVC, ils offrent une durabilité supérieure. Cependant, leur coût élevé limite leur usage aux applications nécessitant une haute performance thermique.
Matériaux biosourcés
Les polymères biosourcés sont fabriqués à partir de ressources renouvelables. Ils sont non seulement plus sûrs pour la santé, mais ils réduisent également l’empreinte écologique liée à la production de plastiques dérivés du pétrole.
Parmi eux, l’huile de soja époxydée (ESBO) représente environ 20 % du marché des alternatives aux phtalates. Utilisée comme plastifiant et stabilisant, elle trouve des applications dans les scellés des bocaux en verre et comme stabilisant UV pour le PVC.
L’acétyl tributyl citrate (ATBC), dérivé de l’acide citrique, est utilisé dans les cosmétiques, emballages alimentaires et jouets. Il est également approuvé pour le contact alimentaire. En revanche, sa solubilité dans l’eau limite son usage dans certaines applications PVC.
Polymères sans plastifiants
Une autre approche consiste à concevoir des polymères qui n’ont pas besoin de plastifiants. Les polymères thermoplastiques élastomères (TPE) sont des matériaux naturellement souples et flexibles, utilisés dans diverses industries. Ils ne nécessitent pas l’ajout de phtalates ou d’autres plastifiants pour obtenir les propriétés recherchées.
Bien que leur coût puisse être plus élevé, les TPE représentent une solution durable pour de nombreuses applications, notamment dans l’automobile, le médical et les produits de consommation, offrant une alternative sûre et performante aux plastiques contenant des phtalates.
La prise de conscience des risques associés aux phtalates a catalysé la recherche d’alternatives plus sûres. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, le défi persiste pour trouver des solutions alliant performance, sécurité et durabilité. La transition vers des matériaux sans phtalates nécessite une collaboration continue entre scientifiques, industriels et régulateurs pour protéger la santé publique et l’environnement.
Soutenez la recherche pour protéger les enfants
des perturbateurs endocriniens !
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
- Substitution des phtalates – INERIS
- L’actualité chimique N° 456-457-458 – Société Chimique de France
- Matériaux au contact | economie.gouv.fr
- ECHA
- Un label « multicritères » | Écolabel
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.