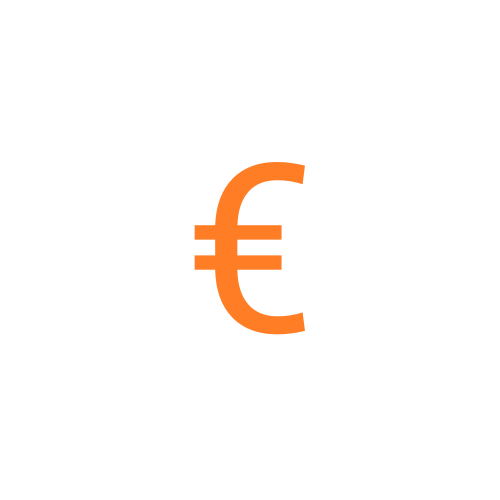Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » Lymphome cérébral : symptômes, diagnostic et prise en charge
Le lymphome cérébral, ou lymphome primitif du système nerveux central (LPSNC), est un cancer rare touchant les cellules lymphatiques du cerveau ou de la moelle épinière. Il se développe directement dans le système nerveux central, sans atteinte initiale ailleurs. Ses symptômes varient selon la localisation de la tumeur. Quels signes doivent alerter et conduire à consulter ? Découvrons ensemble comment reconnaître le lymphome cérébral, quels symptômes orientent vers ce diagnostic et quelles sont les étapes essentielles de sa prise en charge.
Qu’est-ce que le lymphome cérébral (LPSNC) ?
Le lymphome primitif du système nerveux central (LPSNC) est un cancer rare et agressif touchant le cerveau, la moelle épinière, parfois les méninges ou les yeux.
Contrairement aux lymphomes secondaires, il reste initialement limité au SNC (système nerveux central). Dans la majorité des cas, il s’agit d’une prolifération de lymphocytes B diffus à grandes cellules.
Rare, il représente environ 4 % des tumeurs intracrâniennes et touche surtout les adultes entre 50 et 60 ans, avec une légère prédominance masculine.
Le risque augmente en cas d’immunodépression (VIH, traitements immunosuppresseurs), bien que cette forme de lymphome puisse également apparaître chez des personnes dont le système immunitaire fonctionne normalement.
Lymphome cérébral : les symptômes révélateurs du cancer
La présentation clinique d’un lymphome cérébral peut prendre de multiples formes, ce qui rend ses symptômes parfois difficiles à attribuer d’emblée à ce cancer spécifique.
Signes liés à la pression intracrânienne
Lorsque la tumeur augmente la pression intracrânienne, elle provoque typiquement des maux de tête persistants, souvent matinaux, associés à des nausées ou vomissements. Une somnolence peut également survenir.
Ce tableau d’hypertension intracrânienne concerne environ un tiers des patients, lors du diagnostic de lymphome cérébral.
Déficits neurologiques focaux
Le lymphome cérébral peut entraîner des troubles neurologiques localisés selon la zone du cerveau touchée. On observe souvent une faiblesse ou une paralysie d’un côté du corps, des difficultés à marcher ou parler, ou des engourdissements.
Ces signes, fréquents, concernent près de 70 % des patients au diagnostic.
Troubles cognitifs, comportementaux ou confusion
Le lymphome cérébral peut perturber les fonctions mentales, entraînant des changements de personnalité, des troubles de la mémoire ou de l’attention, un ralentissement intellectuel, voire une confusion.
Présents dans 40 % des cas, ces signes peu spécifiques sont parfois confondus avec un vieillissement normal ou un trouble psychiatrique, retardant ainsi le diagnostic.
Crises d’épilepsie
Des crises d’épilepsie (convulsions) peuvent survenir, bien qu’elles soient moins fréquentes dans le lymphome cérébral que dans d’autres types de tumeurs du cerveau.
Environ un patient sur sept présente des convulsions au cours de l’évolution, le plus souvent lorsque le lymphome touche le cortex cérébral.
Atteinte oculaire et médullaire
Dans certains cas, le LPSNC s’étend au-delà du cerveau et atteint les yeux ou plus rarement la moelle épinière.
L’atteinte oculaire, appelée lymphome vitréorétinien, peut entraîner une vision floue, des « mouches volantes » ou une baisse de l’acuité visuelle, bien que ces symptômes soient rares.
Si la moelle est concernée, des douleurs dorsales, une faiblesse des jambes et des troubles urinaires ou intestinaux peuvent apparaître, traduisant une compression médullaire comparable à d’autres tumeurs.
Symptômes généraux
Dans certains cas, le lymphome cérébral s’accompagne de signes généraux appelés « symptômes B » : fièvre, sueurs nocturnes ou perte de poids.
Peu spécifiques et rares dans les formes limitées au cerveau, ils incitent à rechercher une atteinte plus diffuse du lymphome, en dehors du système nerveux central.
Quand consulter en urgence ?
Il est essentiel de consulter en urgence devant certains signes neurologiques, même s’ils ne signifient pas forcément qu’il s’agit d’un cancer. Un avis médical rapide et une imagerie permettent d’en identifier la cause.
Les situations qui doivent alerter sont :
→ déficit soudain : faiblesse d’un bras ou d’une jambe, difficulté à parler, perte brutale de vision ;
→ crise convulsive chez une personne sans antécédent d’épilepsie ;
→ maux de tête inhabituels, surtout s’ils s’accompagnent de vomissements ou de troubles neurologiques (trouble de l’équilibre, difficulté à trouver ses mots).
Mieux vaut ne pas prendre de risque et vérifier, car une intervention précoce améliore la prise en charge quelle que soit la cause sous-jacente.
Diagnostic du lymphome cérébral primitif : examens et parcours de soins
Imagerie en première intention
Le diagnostic du lymphome cérébral repose d’abord sur l’imagerie. L’IRM avec injection de gadolinium est l’examen de référence pour détecter et caractériser les lésions. En urgence, un scanner peut être utilisé.
Plusieurs imageries sont souvent nécessaires : au diagnostic, pendant le traitement et lors du suivi.
Bilan d’extension ciblé
Lorsqu’un lymphome cérébral primitif est suspecté, plusieurs examens complètent l’IRM pour évaluer l’extension de la maladie et confirmer son caractère primitif :
→ examen ophtalmologique (fond d’œil, lampe à fente) pour rechercher une atteinte oculaire ;
→ ponction lombaire pour analyser le liquide céphalorachidien (LCR), utile si suspicion d’atteinte méningée ;
→ recherche de l’ADN du virus Epstein-Barr dans le LCR chez les patients immunodéprimés ;
→ bilan d’imagerie du corps entier et parfois biopsie de moelle osseuse pour éliminer un lymphome systémique.
Confirmation histologique indispensable
Le diagnostic du lymphome cérébral repose sur une biopsie stéréotaxique (prélèvement précis d’un petit fragment de tumeur guidé par imagerie), qui permet d’analyser le tissu au microscope. Cet examen confirme la nature de la lésion.
Les corticoïdes, bien qu’ils réduisent rapidement l’œdème et les symptômes, peuvent faire diminuer ou disparaître temporairement la tumeur, rendant la biopsie faussement négative. Ils ne sont donc utilisés avant le prélèvement qu’en cas d’urgence vitale.
Diagnostics différentiels à éliminer
Le lymphome cérébral peut imiter d’autres maladies, d’où la nécessité d’écarter certains diagnostics grâce à la biopsie. Les principaux diagnostics différentiels sont :
→ gliomes de haut grade ;
→ métastases cérébrales d’un autre cancer ;
→ infections (la toxoplasmose chez un patient VIH, par exemple) ;
→ maladies inflammatoires ou démyélinisantes (comme une sclérose en plaques pseudo-tumorale).
Prise en charge du lymphome cérébral et de ses symptômes : traitements de référence
Induction
Le traitement initial du lymphome cérébral repose sur une polychimiothérapie intensive. Le méthotrexate à haute dose, capable de franchir la barrière hémato-encéphalique, en est l’agent central. Administré par cycles, il est souvent associé à la cytarabine, au thiotépa et au rituximab, permettant d’obtenir des rémissions chez de nombreux patients.
Les corticoïdes (cortisone) peuvent être employés en complément pour soulager rapidement les symptômes, en réduisant l’œdème cérébral. Toutefois, leur effet reste transitoire. Sans chimiothérapie, la tumeur récidive presque toujours. Les stéroïdes sont donc utilisés comme traitement d’appoint, en attendant l’efficacité de la chimiothérapie spécifique.
Consolidation
Après l’induction, une consolidation est nécessaire pour prévenir la rechute. Chez les patients jeunes et en bonne santé, on privilégie une chimiothérapie intensifiée suivie d’une autogreffe de cellules souches. Il s’agit de prélever puis réinjecter les propres cellules souches du patient, pour restaurer la moelle après des doses très fortes de chimiothérapie.
Chez les personnes âgées ou fragiles, on opte plutôt pour une radiothérapie cérébrale à faible dose, afin de réduire le risque de séquelles cognitives.
Soins de support
En plus des traitements spécifiques, les soins de support visent à soulager les symptômes et à préserver la qualité de vie :
→ corticostéroïdes (dexaméthasone) pour réduire temporairement l’œdème cérébral ;
→ antiépileptiques en cas de crises ;
→ rééducation (kinésithérapie, ergothérapie) ;
→ suivi neuropsychologique ;
→ soutien psychologique et social, etc.
Le lymphome cérébral est-il opérable ?
Contrairement à d’autres types de tumeurs, il n’est généralement ni possible ni utile de retirer complètement la lésion par une opération, car le lymphome infiltre souvent le cerveau de façon diffuse et peut être multifocal.
La chirurgie d’exérèse (résection) n’est envisagée qu’exceptionnellement, par exemple si une masse provoque une hypertension intracrânienne aiguë menaçant la vie du patient et qu’il faut la décomprimer en urgence.
Lymphome cérébral du SNC : pronostic de guérison, suivi et rechutes
Le pronostic du lymphome cérébral dépend de l’âge, de l’état général et de la réponse au traitement initial. Les patients jeunes en bonne condition, obtenant une rémission complète, ont de meilleures chances de survie. Globalement, la survie à 5 ans est de 30 à 40 %, selon les études.
Après traitement, un suivi prolongé est essentiel, car près de la moitié des patients rechutent, surtout dans les cinq premières années. Des IRM régulières sont recommandées tous les 3 mois, puis semestrielles, puis annuelles jusqu’à 10 ans. La vigilance des patients reste essentielle face à tout symptôme évocateur, entre deux consultations.
En cas de rechute du lymphome cérébral, la stratégie thérapeutique est décidée au cas par cas. Une rechute tardive peut répondre à une nouvelle cure de méthotrexate haute dose. Dans d’autres situations, des protocoles de polychimiothérapie de rattrapage sont proposés. Ces traitements sont parfois suivis d’une autogreffe de cellules souches.
L’avenir de la prise en charge du lymphome cérébral s’annonce plus encourageant qu’il ne l’a jamais été. Aux côtés de la chimiothérapie classique, de nouvelles pistes comme l’immunothérapie, les thérapies ciblées ou encore les cellules CAR-T ouvrent des perspectives réelles : traiter plus efficacement, avec moins d’effets secondaires, et offrir aux patients une meilleure qualité de vie.
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
• Lymphome primitif du Système Nerveux Central – Campus de Neurochirurgie
• ALD 30 – Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique – Cancer primitif du système nerveux central de l’adulte – HAS
• Lymphomes primitifs du cerveau – Manuel MDS
• Ferreri, A. J., Illerhaus, G., Doorduijn, J. K., Auer, D. P., Bromberg, J. E., Calimeri, T., … & Dreyling, M. (2024). Primary central nervous system lymphomas: EHA–ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 35(6), 491-507
• von Baumgarten, L., Illerhaus, G., Korfel, A., Schlegel, U., Deckert, M., & Dreyling, M. (2018). The diagnosis and treatment of primary CNS lymphoma: An interdisciplinary challenge. Deutsches Ärzteblatt International, 115(25), 419
• Board, P. A. T. E. (2016). Primary CNS Lymphoma Treatment (PDQ®). In PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. National Cancer Institute (US)
• Advances in Lymphoma Research – NCI
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.