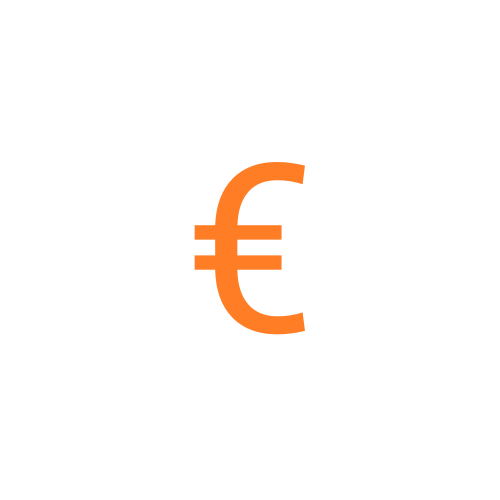Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » Où en est la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ?
La sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative grave touchant les motoneurones, les cellules nerveuses qui commandent les muscles volontaires. Sa progression entraîne une paralysie musculaire généralisée. Quels sont les espoirs concrets pour les personnes atteintes de la maladie ? Où en est la recherche sur la SLA aujourd’hui, en France et ailleurs ? Faisons le point sur les avancées récentes, les traitements en cours d’évaluation et les nouvelles pistes explorées pour mieux comprendre, ralentir et peut-être un jour guérir la sclérose latérale amyotrophique.
Une maladie encore incurable : un besoin urgent de recherche sur la SLA
En France, la SLA concerne près de 8 000 personnes et l’espérance de vie moyenne après les premiers symptômes n’est que de 3 ans environ. Aujourd’hui, aucun traitement ne permet encore de guérir la SLA.
Le Riluzole, prescrit depuis près de 30 ans en France, n’en ralentit que modestement la progression. L’Édaravone, autorisé ailleurs, n’est pas disponible dans l’Hexagone, faute de bénéfice clairement établi.
Cette carence thérapeutique rend la recherche absolument essentielle. Des pistes émergent, comme le Tofersen, premier traitement ciblé sur une mutation génétique rare (SOD1). S’il ne concerne qu’une minorité de patients, il marque un tournant symbolique. En France, son accès reste cependant limité, faute de remboursement dans l’attente de données cliniques plus solides.
Recherche sur la SLA : des pistes prometteuses vers de nouveaux traitements
Thérapies ciblées et génétiques
L’exemple du Tofersen (Qalsody) pour la mutation SOD1 montre qu’il est possible de développer des traitements de précision visant des causes spécifiques de la SLA.
D’autres thérapies géniques sont à l’étude pour des formes héréditaires de la maladie, grâce aux progrès de la biologie moléculaire. Ces traitements ciblent directement les anomalies génétiques ou cellulaires impliquées, ouvrant la voie à une médecine plus personnalisée de la SLA.
Modulation du système immunitaire
Des travaux récents suggèrent que l’inflammation joue un rôle aggravant dans la SLA. L’essai européen MIROCALS a évalué l’interleukine -2 à faible dose (IL-2), une immunothérapie destinée à renforcer les cellules régulatrices du système immunitaire.
Les résultats, publiés en 2023, sont prometteurs. Bien que l’effet global sur la survie soit limité, un sous-groupe de patients présentant certains biomarqueurs a montré une réduction de plus de 40 % du risque de décès. Cette piste d’immunomodulation pourrait donc ralentir la progression de la maladie pour certains profils, justifiant la mise en place d’un essai de phase 3 à plus grande échelle.
Molécules neuroprotectrices et autres médicaments
Plusieurs molécules en cours de développement visent à protéger les motoneurones et à empêcher leur dégénérescence.
L’essai clinique SEALS, lancé fin 2024 en France, teste une molécule innovante auprès de 80 patients recrutés dans une quinzaine de centres SLA à travers le pays. Les résultats de cet essai, attendus au second semestre 2026, diront si ce candidat-médicament permet de ralentir l’évolution de la maladie.
Aux États-Unis, une combinaison de deux molécules (acide tauroursodésoxycholique et phénylbutyrate de sodium, connue sous le nom d’AMX0035) a montré un bénéfice modeste sur la survie, menant à une autorisation de mise sur le marché par la FDA (Food and Drug Administration) en 2022.
Sclérose latérale amyotrophique (SLA) : la recherche clinique s’organise
Unir les forces pour accélérer la recherche sur la SLA
Le réseau national ACT4ALS-MND (Alliance for Clinical Trials in ALS & Motor Neuron Disease) a été créé afin de coordonner les efforts des différents centres SLA du pays. Opérationnel depuis 2020, ce réseau fédère les expertises et facilite la mise en place d’essais cliniques nationaux ou collaboratifs internationaux, qu’ils soient académiques ou industriels.
Grâce à ACT4ALS-MND, plusieurs projets de recherche ont déjà vu le jour, explorant de nouveaux médicaments et même des protocoles de thérapie génique pour la SLA. Cette structuration en réseau renforce la place de la France dans la course scientifique mondiale contre la maladie de Charcot.
Améliorer la qualité de vie des patients grâce à la collaboration internationale
L’étude franco-allemande FG-CoALS (Facteurs Génétiques et Comorbidités dans la SLA), lancée en octobre 2024, illustre l’ouverture internationale de la recherche française sur la SLA et la volonté de partager les connaissances pour faire progresser plus vite les soins.
Cette étude suit plus de 1 000 patients dans 9 centres spécialisés. Elle vise à mieux comprendre les mécanismes liés à la perte de poids rapide, fréquente chez les personnes atteintes de SLA et souvent associée à un mauvais pronostic.
En identifiant les facteurs génétiques, biologiques ou cognitifs impliqués, les chercheurs espèrent permettre d’agir plus tôt et d’améliorer la qualité de vie des patients via des stratégies nutritionnelles personnalisées.
Rapprocher recherche et patients grâce au maillage territorial
Présents sur l’ensemble du territoire, 22 centres référence SLA, souvent intégrés aux CHU, assurent à la fois le suivi des patients atteints de la maladie et leur participation à la recherche.
Ces centres intègrent les patients dans des essais cliniques lorsqu’ils sont éligibles, garantissant ainsi que les avancées scientifiques bénéficient rapidement aux malades.
Avancées technologiques : Innover pour la SLA
À Lyon, le projet Huma 7T porté par la Fondation HCL vise à installer une IRM 7 Tesla, cinq fois plus performante que les appareils classiques, pour révéler les détails cérébraux invisibles à ce jour. Cette technologie permettra des diagnostics plus précoces et précis, tout en affinant le suivi de la maladie.
Couplée à l’IA, elle promet d’accélérer l’analyse des images, d’identifier de nouveaux biomarqueurs et de personnaliser les traitements. Ces outils technologiques ouvrent une nouvelle ère pour mieux comprendre et traiter la SLA.
Défis et perspectives de la recherche sur la maladie de Charcot (SLA)
La SLA est une maladie complexe où dégénérescence motrice, facteurs génétiques multiples et inflammation convergent.
Les dernières années ont vu d’importantes avancées dans la recherche sur la SLA. Les essais cliniques n’ont jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui, signe d’une véritable mobilisation scientifique. En France, le 4ᵉ Plan National Maladies Rares (2025–2030) vise à renforcer les moyens dédiés à l’innovation, à la coordination des soins et à la coopération européenne.
Chaque progrès thérapeutique, scientifique ou technologique nourrit un espoir grandissant. Les experts, prudemment optimistes, misent désormais sur une combinaison de traitements complémentaires qui permettrait de mieux contrôler la maladie.
Pour atteindre ce but, il est indispensable de maintenir les investissements et les financements publics. Le soutien du grand public, par ses dons, reste un moteur précieux pour accélérer la recherche.
Si la SLA reste aujourd’hui une maladie impitoyable, la mobilisation scientifique qu’elle suscite est un motif d’espoir. Grâce aux progrès de la recherche, de nouveaux traitements sont en vue, des outils de diagnostic révolutionnaires se mettent en place et la compréhension de la maladie s’affine.
⏩ Découvrez comment l’IRM 7 Tesla révolutionne la recherche neurologique.
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
• La SLA : des enjeux majeurs d’accès aux traitements, d’innovation et de recherche – France Assos Santé
• SLA : Une étude franco-allemande inédite pour mieux comprendre et combattre la perte de poids – F-CRIN
• Bensimon, G., Leigh, P. N., Tree, T., Malaspina, A., Payan, C. A., Pham, H. P., … & Al-Chalabi, A. (2025). Efficacy and safety of low-dose IL-2 as an add-on therapy to riluzole (MIROCALS): a phase 2b, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet, 405(10492), 1837-1850.
• ALS Phase II Study of NX210c – ClinicalTrials.gov
• FG-CoALS – France Cohortes
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.