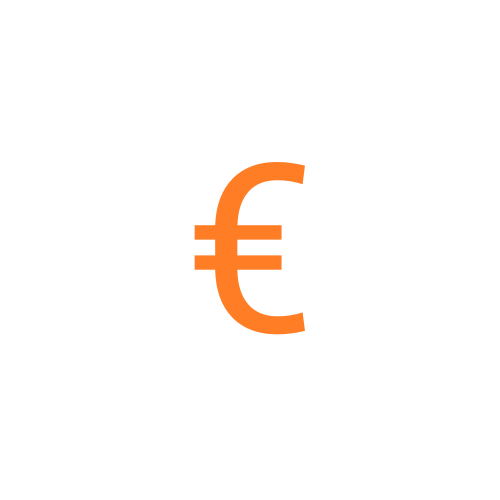Merci pour votre inscription à la newsletter
Accueil » Notre-action » Recherche-et-innovation » Informations-sur-les-maladies-et-la-recherche-medicale » Peut-on vraiment soigner Alzheimer ? État des lieux des traitements et innovations
La maladie d’Alzheimer, véritable défi de notre temps, affecte des millions de personnes. Mais peut-on vraiment vaincre cette maladie neurodégénérative, ou tout au moins stopper son évolution ?
Faisons le point sur les thérapies actuelles pour tenter de comprendre quel est le meilleur traitement pour Alzheimer à l’heure actuelle, et dressons un état des lieux des avancées médicales les plus prometteuses.
Quel est le meilleur traitement pour Alzheimer ?
Parce qu’Alzheimer reste incurable, on parle de prise en charge pour accompagner, ralentir l’évolution et améliorer la qualité de vie.
Existe-t-il un traitement pour guérir d’Alzheimer ?
Actuellement, il n’existe aucun traitement curatif pour la maladie d’Alzheimer. Les traitements disponibles ne font qu’atténuer les symptômes ou ralentir temporairement la progression de la maladie, sans éliminer la cause sous-jacente.
En d’autres termes, aucun « médicament miracle » ne peut encore guérir ou inverser complètement cette démence. Néanmoins, la prise en charge des patients s’est considérablement améliorée et de nouvelles thérapies prometteuses commencent à émerger.
Comment choisir le traitement le plus adapté pour une personne Alzheimer ?
Le « meilleur » traitement d’Alzheimer dépend du profil de chaque patient et du stade de la maladie. Les médecins spécialistes évaluent les symptômes, l’âge et l’état général de la personne, pour proposer la stratégie thérapeutique la plus adaptée.
Généralement, on associe les médicaments à des approches non médicamenteuses (stimulation cognitive, thérapies psychosociales). Ainsi, la prise en charge est ajustée au cas par cas pour en renforcer l’efficacité.
Quel traitement pour ralentir Alzheimer ?
Bien qu’on ne puisse pas guérir Alzheimer, plusieurs médicaments peuvent en ralentir la progression.
Les inhibiteurs de la cholinestérase pour les stades précoces à modérés
Les traitements de première intention sont les inhibiteurs de la cholinestérase (par exemple le donépézil). Ces médicaments, indiqués aux stades légers à modérés, augmentent le neurotransmetteur acétylcholine dans le cerveau.
Ils ralentissent modestement le déclin cognitif et peuvent améliorer temporairement la mémoire, le langage ou l’autonomie des patients.
La mémantine pour les formes plus avancées
La mémantine, un antagoniste des récepteurs NMDA du glutamate, est prescrite aux stades modérés à sévères.
Elle vise à éviter la surstimulation toxique des neurones et aide à stabiliser les capacités cognitives résiduelles des patients à un stade avancé. Sans stopper la maladie, ce traitement peut apporter un mieux appréciable quand les troubles deviennent plus importants.
Limites et effets secondaires des traitements actuels
Ces traitements ne font que ralentir la maladie, sans l’arrêter. Leur efficacité s’estompe après environ 2 à 3 ans, la neurodégénérescence reprenant ensuite le dessus.
Par ailleurs, ils peuvent entraîner des effets indésirables :
→ troubles gastro-intestinaux (nausées, perte d’appétit…) ;
→ ralentissement du rythme cardiaque ;
→ états confusionnels.
Le médecin doit donc réévaluer régulièrement la balance bénéfice-risque.
Traitement d’Alzheimer : quelles innovations médicales pourraient changer la donne ?
Des traitements innovants ciblent directement les mécanismes de la maladie, augurant de futures avancées.
Anticorps monoclonaux anti-amyloïdes
Des anticorps monoclonaux ciblant les plaques amyloïdes (le lécanémab, par exemple) ont montré qu’ils pouvaient ralentir d’environ 25 % le déclin cognitif chez des patients au stade précoce.
En éliminant la protéine bêta-amyloïde du cerveau, ces traitements attaquent une cause de la maladie.
Toutefois, ils ne représentent pas un remède et comportent des risques d’effets secondaires graves (œdèmes cérébraux, micro-hémorragies), qui limitent leur usage.
Nouvelles pistes thérapeutiques
Les chercheurs explorent aujourd’hui plusieurs pistes complémentaires pour mieux comprendre et freiner la maladie d’Alzheimer.
L’une d’elles concerne la protéine tau, qui s’accumule de façon anormale dans les neurones et perturbe leur fonctionnement. Des vaccins et des médicaments capables d’empêcher cette accumulation sont en cours de test.
Par ailleurs, l’inflammation du cerveau, qui aggrave les lésions, fait l’objet d’essais avec des substances capables de calmer ou de réguler la réponse immunitaire.
Le rôle du métabolisme, notamment de l’insuline dans le cerveau, fait aussi l’objet d’études, même si les résultats restent incertains.
Quant à la santé du cœur et aux hormones (comme les œstrogènes), elles semblent influencer le risque d’Alzheimer, ouvrant la voie à des approches de prévention plus globales.
Espoirs liés au diagnostic précoce et à l’imagerie cérébrale
Le diagnostic précoce représente un enjeu important, pour améliorer la prise en charge. Grâce à l’imagerie (PET scan amyloïde, IRM), on peut détecter les lésions d’Alzheimer (plaques, atrophie) bien avant les symptômes.
De plus, un test sanguin p-tau 217 permet de diagnostiquer la maladie beaucoup plus tôt. Repérer Alzheimer dès ses débuts offrirait la possibilité d’initier les traitements plus tôt et d’anticiper le parcours de soins.
Prises en charge complémentaires de la maladie d’Alzheimer
L’accompagnement global du patient est essentiel pour maintenir sa qualité de vie.
Stimulation cognitive et thérapies psychosociales
La stimulation cognitive (ateliers mémoire, jeux, exercices) joue un rôle essentiel pour entretenir les capacités mentales. Des études montrent qu’elle apporte un bénéfice notable sur les fonctions cognitives et le bien-être des patients.
Par ailleurs, les thérapies psychosociales (art-thérapie, musicothérapie, réminiscence, etc.) offrent aux malades des moments d’échange, de plaisir et de valorisation des capacités préservées.
Ces activités sociales et créatives améliorent l’humeur et la communication, contribuant à maintenir une meilleure qualité de vie.
Traitements symptomatiques et cadre de vie adapté
Un environnement de vie adapté est indispensable pour réduire les troubles du comportement. Il faut sécuriser le domicile (enlever les dangers, prévoir des repères visuels) et instaurer des routines simples et rassurantes, afin d’atténuer l’anxiété et la confusion du malade.
Certains médicaments symptomatiques (anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques) peuvent aider à contrôler l’agitation ou les troubles sévères du comportement, mais uniquement en dernier recours compte tenu de leurs effets secondaires chez les patients âgés (par exemple, augmentation du risque d’AVC sous antipsychotiques).
Accompagnement des aidants et de l’entourage
Les proches aidants ne doivent pas être oubliés. S’occuper d’un parent Alzheimer génère souvent un stress intense et un risque d’épuisement pour l’aidant. Il est donc indispensable de les soutenir.
Des solutions de répit existent (accueil de jour, aide à domicile, groupes de parole) pour offrir aux aidants du repos et du soutien. Préserver la santé de l’aidant, c’est aussi garantir une meilleure assistance au patient sur la durée.
En dépit de l’absence de remède curatif, les traitements actuels et l’accompagnement humain offrent des réponses pour mieux vivre avec Alzheimer. Les innovations médicales et le diagnostic précoce nourrissent l’espoir que cette maladie pourra un jour être vaincue.
⏩Découvrez le projet HUMA‑7T, véritable révolution dans l’imagerie du cerveau contre Alzheimer.
Cet article reflète les connaissances disponibles à sa date de rédaction. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances scientifiques, certains éléments abordés pourraient ne plus être entièrement actuels ou complets au moment de votre consultation.
Sources :
• Alzheimer’s treatments: What’s on the horizon? – Mayo Clinic
• Huang, L.-K., Kuan, Y.-C., Lin, H.-W. & Hu, C.-J. (2023). Clinical trials of new drugs for Alzheimer disease: a 2020-2023 update. Journal of Biomedical Science, 30(1), 83.
• Van Dyck, C. H., Swanson, C. J., Aisen, P. S., et al. (2023). Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease. New England Journal of Medicine, 388(1), 9-21.
• Xiao, D., et al. (2024). Current therapeutics for Alzheimer’s disease and clinical trials. Exploration Journal.
• Cummings, J. L. (2025). Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2025. Alzheimer’s & Dementia Translational Research & Clinical Interventions.
• Xing, H., et al. (2025). Recent advances in drug development for Alzheimer’s disease. International Journal of Molecular Sciences, 26(8), 3905.
⏩ Pour aller plus loin, découvrez tous nos contenus sur le sujet.